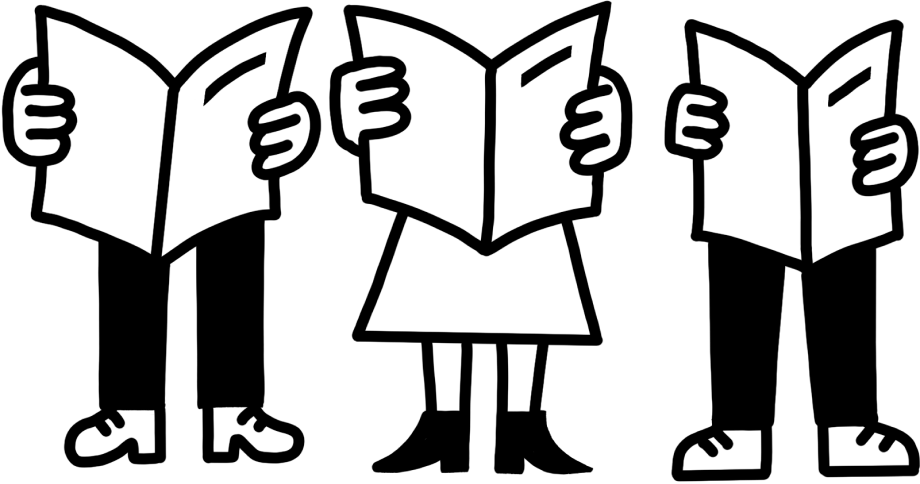Petit matin. Étienne nous embarque dans son bateau, au Conquet. Vingt minutes de mer. Les phoques gris viennent jouer près de nous, nous regardant de leurs grands yeux bruns et doux. Nous arrivons sur la cale glissante d’algues de Quéménès. Un goéland marin, immense et patibulaire, monte la garde sur la cheminée de la ferme. C’est là que nous attendent Amélie et Mathurin. On prend le temps d’arriver. Car de part et d’autre du chemin – merveille –, les prairies déroulent une nature d’un autre âge.
On appelle « mille-fleurs » ces tapisseries du Moyen Âge aux fonds verts, parsemées de plantes et de fleurs : il y a des ressemblances avec Quéménès. Basse sur l’eau, sans arbre, grande de 1300 mètres sur 300, elle ne dépasse des vagues que de 12 mètres en son point culminant. Une petite dune de galets borde l’estran. En son sein, les roches forment des courbes douces au creux desquelles s’est déposé un sol fertile. Mauves, silènes, chardons, trèfles, liserons des dunes et fougères aigle en forment les motifs, entrecoupés de murets de pierres. Dans les airs, goélands marins, pipits, sternes, huîtriers pie, hirondelles s’entrecroisent. Point de bruit de moteur, sauf au loin, de temps en temps, un bateau de pêche qui passe ou, si on le démarre, l’un des deux tracteurs de l’île.
Mille fleurs d’un biotope exceptionnel, propriété du Conservatoire du littoral, qui s’entretient : il y a six ans, Amélie Goossens et Étienne Menguy, alors âgés de 30 ans, reprennent le fermage de l’île. À charge pour eux de veiller sur son environnement naturel, son bâti, de cultiver cinq hectares précisément situés pour ne pas déranger les oiseaux, et d’accueillir un public choisi. Dix personnes à la fois, pour des séjours de trois jours et deux nuits, à la belle saison, en pension complète. Ni l’un ni l’autre issus du monde agricole, ils ont tout appris en faisant. Il y a quatorze mois, Mathurin est né : petit bonhomme confiant, il parcourt depuis peu sur ses gambettes les chemins dont sa maison est le centre. Émerveillé par une coccinelle, un papillon, une fleur, et par les tracteurs. Son vocabulaire actuel comporte autant de cris d’oiseaux (le goéland, le bébé hirondelle et la poule) que de mots humains (maman, papa, tac – pour « tracteur »).


C’est Amélie qui nous accueille dans la chaleureuse salle à manger commune, dominée par une longue table et une imposante cheminée de pierre. En effet, le temps de débarquer sur l’île, voilà Étienne déjà reparti. La marée n’attend pas : il échoue le bateau à marée basse sur un estran propice pour cueillir à la main la dulse. À pied, en les coupant au-dessus du crampon afin de permettre leur repousse, et sans jamais récolter totalement un champ. C’est la seule manière autorisée de ramasser les algues de cette zone protégée. À marée haute, ces algues fraîches sont envoyées vers le continent chez des transformateurs pour la restauration, l’alimentation, l’industrie. Cinq heures de cueillette « très physiques », admet-il au retour. L’activité, aux débouchés ultramodernes, est pourtant archaïque : l’île porte la trace des maisonnettes des goémoniers d’antan, dits « pigouliers » dans l’archipel de Molène. Une vie de forçat, que chante Michel Tonnerre dans une chanson célèbre en Bretagne, Les Goémoniers :
Il est des hommes de ma terre
Aux berges du pays breton
Qui sont moissonneurs de la mer
Et récoltent le goémon



On voit encore les courtes tranchées cerclées de pierres qui permettaient d’obtenir des pains de soude, vendus à l’industrie du verre. Ces fours ont brûlé jusque dans les années 1950, quand la fabrication chimique d’un matériau de qualité supérieure les a rendus obsolètes.
Le « bail », reconductible, a été signé pour neuf années avec le Conservatoire du littoral. « Il faudra savoir partir : ce n’est pas “notre” île. Nous sommes de passage, comme ceux qui étaient là avant nous. » Une mémoire à laquelle Amélie est sensible. « J’appréhendais le ressenti qu’on aurait de l’histoire de toutes les personnes qui ont vécu ici, depuis le Néolithique. Dans une île, tu te sens plus dans la passation entre habitants. » Elle a su trouver un fil et le nouer : « Tu vois ce tableau, dans la salle à manger commune ? J’ai offert un cadre vide à la fille de l’ancien propriétaire de l’île, avant son rachat par le Conservatoire du littoral – aujourd’hui une dame d’un certain âge, qui a grandi ici. Elle a rempli ce cadre de “son” Quéménès : une photo de mariage de ses parents, des articles de journaux. Elle a aimé qu’on soit sensibles à tout ce travail fait ici par ses parents. » De passage. Amélie est ferme : après, « on fera tout autre chose ! Et Mathurin pourra aller à l’école. » D’ici là, ses parents prévoient de l’instruire à la maison. « Il y a bien une école à Molène, l’île voisine, avec une classe unique. Mais il faudrait traverser matin et soir : c’est trop incertain ici. »
« Paysans-marins », comme se définissent les fermiers de Quéménès, ils dépendent plus encore des conditions météorologiques que les autres agriculteurs. « Tout est exacerbé sur une île », confirme Amélie, qui, pas un seul jour en quatre ans, n’a « regretté [s]on choix ». « Une île hostile, en hiver, c’est vrai », mais où elle n’a pas hésité à faire un enfant. « Je n’ai jamais eu peur. » Au contraire. Si Étienne est « [s]on roc », Quéménès l’est aussi pour cette ancienne enfant anxieuse, bonne élève, soucieuse de faciliter l’existence d’une mère qui l’élève seule, à Tourcoing. Son père, un immigré d’origine turque, arrive en France dans les années 1970. Il est ouvrier dans l’industrie textile, à l’usine où sa mère est secrétaire. La différence de culture entres les familles des deux futurs parents est trop grande. Elle a raison de leur désir de s’épouser. Amélie a une « belle enfance », c’est important pour elle de le dire, mais elle est marquée par cette histoire. Alors, ses deux rocs, Étienne et Quéménès, c’est ce qui lui convient en ce moment de sa vie. L’île n’est pas synonyme d’isolement, mais de force. « J’ai vu nos brebis mettre bas avant d’avoir mon enfant. La première fois que j’ai vu un agnelage, avec le petit qui se dresse sur ses quatre petits sabots au bout d’un quart d’heure, la nature m’a rendue confiante dans ma capacité d’être un mammifère, capable », sourit-elle. Et si sa grossesse a nécessité un voyage par mois sur le continent, sur le petit bateau qui tape fort sur les vagues, elle s’en est toujours bien trouvée. Elle est suivie par une sage-femme, à Brest : « Sophie, géniale, que je connaissais car elle était venue pour un séjour sur l’île. J’ai tout de suite pensé à elle quand le test de grossesse (périmé !) que je traînais dans mes affaires s’est révélé positif. Il m’en reste un du même paquet, rit-elle, au cas où ! »





À Étienne, la vie sur l’île a rendu le plaisir de travailler de ses mains et de tout son corps, lui qui s’ennuyait, « calculateur dans un bureau d’études » pendant les sept ans qui ont précédé Quéménès, tandis qu’Amélie se fatiguait en allers-retours vers un emploi situé trop loin de leur domicile. « On est complémentaires », selon le plus taiseux des deux. « C’est sa folie qui m’a fait me projeter, sourit-elle. Lui, il est à la tête des travaux des champs, des cultures, des travaux. Moi, je fais l’administratif, la communication, la commercialisation : je trouve les débouchés pour les produits. On est ensemble sur la maison d’hôtes. À la base, je cuisine plus, mais maintenant qu’il y a Mathurin, on se partage tout. » Le loyer de l’île coûte entre 7 et 9 000 euros par an, mais le couple « s’en sort bien », se réjouit Amélie avec 100 000 euros de chiffre d’affaires annuel, qui provient à 70 % de l’agriculture et à 30 % de la maison d’hôtes.
L’hiver, quand « la capuche ne tient pas sur la tête, dehors », la petite famille se replie dans le calme de sa maisonnette chauffée au bois, au milieu des vents et des vagues. C’est le temps des bricolages, rangements, projets et réflexions. Se sentent-ils parfois isolés ? « Jamais, explique Amélie. Je passe nos commandes sur Internet, qu’Étienne passe prendre quand il livre nos produits. Et il y a notre site Internet à gérer, ainsi que les réseaux sociaux. » Amélie s’est formée à des logiciels de graphisme avec lesquels elle décline l’identité visuelle de leur marque, durant les mois froids, à partir d’un logo imaginé par une élève d’école d’arts graphiques. Le dessin rappelle les veines du bois, ou les courbes de niveau d’une carte marine : les deux passions du couple élégamment représentées. Une éolienne procure l’électricité nécessaire à toutes ces activités, relayée par beau temps par des panneaux solaires posés sur le toit d’une grange.
Pour l’heure, c’est la pleine saison. Il faut récolter les légumes : pommes de terre, oignons, échalotes, ail ; trier, ensacher, apporter sur le continent. Les légumes fournissent une quarantaine de magasins et de restaurants, mais aussi la cantine municipale de l’école primaire du Conquet ainsi que l’Ehpad de la ville. Pour les anciens, c’est un plaisir particulier, car la pomme de terre de Quéménès est réputée au Conquet, de longue date.



La pomme de terre fatigue le sol : Étienne et Amélie pratiquent une rotation des cultures sur quatre ans. Les alliacées prennent le relais l’année suivant les tubercules puis, pendant deux ans, c’est le tour des « engrais verts » – millet, sarrasin, moutarde, phacélie. Des végétaux dont la culture amende les terres, avec le goémon, épandu une fois l’an, à l’ancienne. Rien d’autre. Bien sûr, la ferme possède le label Agriculture biologique.Il y a de ravissants lapins sur les tapisseries « mille-fleurs », comme la Dame à la licorne. Il y en a aussi à Quéménès, mais nettement moins innocents. Devant une de ses prairies constellées de fleurs, survolée de papillons et d’oiseaux, Amélie se réjouit : « Ici, l’année dernière, c’était ras ! Il n’y avait que des chardons. Tout était ravagé. » Les longues-oreilles sont une plaie pour l’écosystème de l’île. Un navire espagnol les y aurait relâchés, au XVIIᵉ siècle, pour s’y faire un garde-manger. « Nous les transportons vivants (mille en deux ans, quand même !) sur le continent. » Ils sont vendus pour repeupler des zones où l’espèce ne se maintient plus. « Les gens d’ici nous prennent pour des fous, car le lapin est tabou sur les bateaux – superstition de marins. » Ils ne voulaient pas de carnage sur l’île pour les éliminer : Étienne est allé se former pour obtenir un agrément piégeur ainsi qu’une autorisation de transport d’animaux vivants… Et mille lapins ont été emmenés batifoler ailleurs. Une folie ? « C’est sûr ! », rit la dame de cette tapisserie, à laquelle le couple a rendu ses mille fleurs.
Un reportage à retrouver en intégralité dans Bobine n°3 – Périphérie.