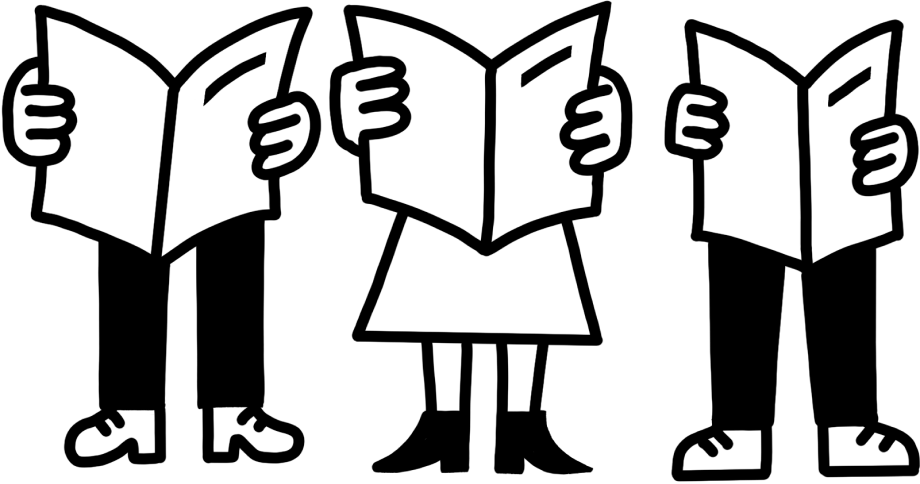Dans les Montagnes du Jura, l’immensité des forêts dessine un paysage majestueux. Ici, le bois est bien plus qu’une simple ressource : il relie les habitants à leur histoire. Tourneurs, ébénistes, tavaillonneurs ou encore maîtres-pipiers perpétuent des siècles de savoir-faire et de traditions profondément enracinés dans la région. En plein cœur de l’hiver, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui, au quotidien, côtoient cette matière vivante, toujours au centre de la vie jurassienne.
« En haut des cimes, on se rend compte que la neige, le ciel et l’or ont la même valeur. », écrivait Boris Vian. À mesure que la route s’élève vers le Haut-Jura, le paysage se métamorphose. Les arbres se parent d’un manteau blanc, la lumière joue avec les cimes, et seul le crissement de la neige sous nos pas trouble le silence des Montagnes du Jura.
Nous prenons de l’altitude, et avec elle, une nouvelle perspective : derrière la beauté brute des montagnes, il y a ces femmes et ces hommes qui les habitent et les façonnent, ancrés dans ces terres comme les racines des arbres centenaires. Leur attachement au territoire se lit dans leurs gestes, dans leurs récits, et dans cette relation intime qu’ils entretiennent avec ce paysage si singulier.
→ Jour 1 – De Lamoura à La Pesse
L’appel de la forêt à Lamoura
Saviez-vous que l’expression « Massif du Jura » signifie « forêt de montagne » en vieux gaulois ? On raconte que la forêt se serait installée dans les Montagnes du Jura il y a plus de 7000 ans. Elle couvre aujourd’hui près des deux tiers du massif et constitue l’une des plus vastes forêts naturelles de moyenne montagne. Réputées pour ses sapins et ses épicéas dont les bois ont récemment été reconnus par une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), les forêts du Jura se distinguent par une grande diversité d’essences : épicéa, sapin président, chêne, frêne, hêtre, noyer ou encore érable.
Ce matin de décembre, à Lamoura, au coeur des Montagnes du Jura, le soleil d’hiver perce à travers les branches encore embaumées d’une neige fraîche. Sur le parking à l’entrée du village, nous attendons Rémi Basmaji, accompagnateur en moyenne montagne. Bonnet vissé sur la tête et sourire franc, il arrive d’un pas léger, comme chez lui. Ici, il l’est devenu. Pourtant, il n’est pas jurassien de naissance. Haut-Marnais, il a découvert ces montagnes par son frère avant de s’y installer, happé par l’immensité du massif et de ses forêts profondes : « Je suis tombé amoureux des Montagnes du Jura en le parcourant. Petit, j’étais déjà attiré par la nature, mais ici, j’ai trouvé un territoire à la fois sauvage et accueillant. », confie-t-il en s’engageant sur le sentier.


Nous nous enfonçons dans la forêt. Loin des sommets acérés des Alpes, les Montagnes du Jura déploient une autre magie, plus intime, presque féerique. Rémi les connaît comme sa poche : « On n’entre pas dans cette forêt comme dans un simple bois. Il faut prendre le temps de l’apprivoiser, de l’observer. Ici, tout est question de patience. » Lui en a eu, et il a été récompensé. Un matin d’hiver, dans ces forêts, il a croisé le lynx : « C’est un privilège rare, on sent qu’on touche à quelque chose de précieux. » Plus tard, c’est le grand tétras qu’il apercevra, oiseau mythique du Jura, dont la survie est menacée.
Car si le massif enchante, il inquiète aussi. Rémi observe, année après année, les signes du changement climatique : « Les épicéas dépérissent, attaqués par les scolytes. La forêt souffre, et avec elle, tout l’équilibre du vivant. » Son rôle de guide ne se limite pas à montrer la beauté des lieux, il s’agit aussi de sensibiliser, d’éveiller à la fragilité de ce patrimoine : « Il faut que les gens comprennent que ce qu’ils trouvent beau aujourd’hui ne sera peut-être plus là demain si l’on n’y prête pas attention. »
Il est déjà temps de redescendre, de laisser derrière nous cette forêt qui n’a pas encore livré tous ses secrets. L’échappée fut brève, mais elle offre un avant-goût d’un territoire qui a tant à raconter.
- Sentiers Libres, En Ripaille, 39400 Longchaumois
Le coffre-fort du Haut-Jura à Lajoux
L’humain a su se fondre dans les Montagnes du Jura sans les dénaturer, bâtissant avec intelligence et humilité. L’un des témoignages les plus fascinants de cet ancrage est le grenier-fort qui se dresse encore dans certains villages du Haut-Jura. À Lajoux, à proximité de la Maison du Parc naturel régional du Haut-Jura, se trouve l’un des rares spécimens que l’on peut encore visiter : le grenier-fort du Thoramy. Une clé massive est remise à celles et ceux qui souhaitent en pousser la porte. Derrière le battant épais, c’est tout un pan du patrimoine jurassien qui se dévoile.
« Ces greniers-forts sont des refuges pour la mémoire. », explique Caroline Bergamasco, médiatrice à la Maison du Parc naturel régional du Haut-Jura. « Ils racontent une époque où tout pouvait partir en fumée en une nuit, et où il fallait protéger l’essentiel. » Car c’est bien la peur du feu qui a donné naissance à ces constructions. Au 18e siècle, les fermes du Haut-Jura, avec leurs façades en tavaillons, leurs granges remplies de foin et leurs immenses cheminées de bois, étaient de véritables poudrières. Un incendie pouvait réduire en cendres des années de dur labeur, laissant les familles sans ressources pour affronter les rigueurs de l’hiver. Pour conjurer ce péril, les haut-jurassiens eurent une idée lumineuse : bâtir, à une trentaine de mètres des habitations, de petits édifices hermétiques où entreposer leurs biens les plus précieux.




Faits de madriers de sapin ou d’épicéa massifs, les greniers-forts se distinguent par leur absence de fenêtres et leur double porte épaisse, verrouillée par une serrure imposante. À l’intérieur, on stockait bien plus que du grain : farine, légumes secs, sucre, sel, conserves, alcool, vêtements du dimanche, outils précieux, cloches des bêtes, livres de comptes et même, parfois, des documents notariés. Sous le plancher, une cave creusée dans le sol servait à entreposer pommes de terre, carottes et navets, à l’abri du gel. La température y variait peu, été comme hiver, assurant une conservation optimale des vivres et évitant ainsi des famines en cas de mauvaise récolte.
Bien que typiquement jurassien, le grenier-fort rappelle d’autres bâtisses de montagne, comme les chalots vosgiens ou les raccards suisses. Une filiation qui s’explique en partie par les migrations savoyardes du 17e siècle, lorsque les abbés de Saint-Claude firent venir de nouvelles populations pour repeupler les vallées désertées après la guerre de conquête. Aujourd’hui, on en recense encore environ 190 dans le Jura Sud, mais beaucoup tombent en ruine, faute d’entretien et de réhabilitation : « Si rien n’est fait, ils disparaîtront. », prévient Caroline Bergamasco. « Ce serait une perte immense, car ils sont le reflet d’un mode de vie, d’une adaptation à un environnement rude et exigeant. »
Conscient de cette urgence, le Parc naturel régional du Haut-Jura a choisi de sauver le grenier-fort du Thoramy, menacé par le temps et l’oubli. Racheté en 1984, il a fait l’objet d’une restauration exemplaire, menée en collaboration avec des artisans dont Loïc Gautheret, tavaillonneur. L’intervention ne se voulait pas seulement patrimoniale, mais aussi pédagogique : en démontant et reconstruisant ce grenier selon les techniques traditionnelles, les artisans ont pu se réapproprier un savoir-faire ancestral. Aujourd’hui, le bâtiment trône fièrement sur les hauteurs de Lajoux comme un gardien veillant sur l’histoire des humains et des forêts des Montagnes du Jura. Il peut-être visité sur demande auprès de la Maison du Parc naturel régional du Haut-Jura.
- Maison du Parc naturel régional du Haut-Jura, 29 Qur le Village, 39310 Lajoux






Haut perché à La Pesse
Après les greniers-forts, les Montagnes du Jura nous ouvrent une autre porte : celle des Loges du Coinchet. Ici, à 1 200 mètres d’altitude, dans un coin préservé de La Pesse, la forêt veille sur des cabanes de bois comme on veille sur un secret bien gardé. Ces refuges nichés au creux des épicéas ne sont pas de simples hébergements : ce sont des invitations à ralentir, à retrouver l’essentiel.
Derrière ce havre de sérénité, il y a Martine, l’âme des lieux. Venue de l’Auvergne il y a trente ans, elle a posé ses valises ici, portée par un coup de cœur pour cette terre jurassienne : « Le Coinchet, c’est un lieu qu’on a tout de suite envie de partager. », dit-elle. C’est d’abord chez elle qu’elle s’est installée, dans une ancienne ferme dont les murs recouverts de tavaillons racontent l’histoire du pays. Puis, presque naturellement, l’accueil est devenu une évidence. Construire des cabanes en bois du Jura, travailler avec des artisans du village, privilégier les circuits courts avant même que le mot ne devienne une mode : tout s’est fait dans la continuité de ce qu’elle défend depuis toujours.
Les Loges du Coinchet, ce sont donc des cabanes perchées dans les arbres ou encore une cabane trappeur, toutes pensées pour un moment d’évasion et de quiétude, sans jamais s’éloigner de l’essence du territoire. On y dort dans le parfum du bois et on se réveille avec des lumières que seul le Jura semble pouvoir offrir. Le soir, au coin du feu, les conversations s’échangent autour d’un repas fait maison, à base de produits locaux (comté, morbier, vins du Jura…).
Aujourd’hui, Martine n’est plus seule à faire vivre ce lieu. Léna, qui a participé au lancement du projet et qui est revenue il y a trois ans, s’investit jour après jour, et l’avenir des Loges semble déjà se dessiner sous ses mains. « La transmission, c’est une évidence. », confie Martine, qui se rapproche doucement de la retraite. Il y a dans ce passage de relais une belle continuité, comme un fil qui ne se coupe pas. Parce que ce lieu est plus qu’une adresse : il est une manière d’être, une manière d’habiter les Montagnes du Jura, et ceux qui y viennent repartent avec un peu de cet esprit-là.
- Les Loges du Coinchet, Le coinchet, sur le crêt, 39370 La Pesse



→ Jour 2 – D’Arinthod à Saint-Claude
La « Bête à bois » d’Arinthod
Dans les Montagnes du Jura, le bois et ses multiples essences ont donné naissance à des savoir-faire uniques. Dès le 11e siècle, les moines bénédictins de l’abbaye de Saint-Claude façonnaient les premiers jeux en bois, aux côtés d’objets religieux prisés par les pèlerins, comme les chapelets et les statuettes. Au début du 20e siècle, le Haut-Jura a compté jusqu’à 7 600 tourneurs sur bois, spécialisés dans la fabrication de bilboquets, cordes à sauter, jeux d’échecs et autres jouets en bois qui ont traversé les générations. De nos jours, et malgré les difficultés de l’activité, quelques artisans se battent pour maintenir ces savoir-faire qui font la renommée de la région. Parmi eux, Bruno Thomas, un artisan du bois qui a trouvé son bonheur dans cette matière et la fabrication de jeux coopératifs.
C’est dans le village d’Arinthod, au cœur de la Petite Montagne jurassienne, que Bruno, surnommé « Bête à bois », a trouvé ses repères et le sens qu’il souhaitait donner à sa nouvelle vie. Cet ancien chargé de production dans les quartiers de La Défense à Paris, a un jour décidé de quitter « cette fourmilière humaine » pour se reconnecter à la nature. Il trouve alors la quiétude dans les Montagnes du Jura et enchaîne les boulots : perchiste, agent de sécurité, auxiliaire de puériculture… « À force d’enchaîner les métiers, cela m’a donné des critères supplémentaires pour me dire “ça je n’en ai plus envie”. », explique Bruno. Fasciné par les arbres et nourri par les balades en forêt, où il animait des activités sur le thème du sens, il se prend de passion pour le bois.

Autodidacte, il commence par explorer les richesses de cette matière sur son temps libre avant de faire de cette passion son métier à plein temps. « J’ai eu envie de travailler la matière, de savoir me servir de mes mains. », résume Bruno. Comme un hommage aux anciens, il a à cœur de respecter la notion même du geste de l’artisan, mais aussi d’honorer l’arbre. Cela passe notamment par la prise en compte du calendrier lunaire pour la coupe du bois : « Nos anciens le faisaient systématiquement, ce n’était jamais remis en cause ». Nos ancêtres avaient effectivement remarqué qu’en coupant le bois « hors sève », c’est-à-dire en lune descendante et quand les arbres sont en repos végétatif, le bois séchait plus vite et était de meilleure qualité.
À la manière de Geppetto qui donna vie à Pinocchio, Bruno perçoit le bois comme un être vivant évoluant avec des imperfections qui révèlent tout le charme de la matière. Jeux d’invention, jeux d’équilibre ou bien jeux de coordination, l’artisan s’inspire de ses expériences passées au sein de l’éducation populaire et de la petite enfance pour créer de véritables outils de développement cognitif et sensoriel : « Nos enfants, nos anciens et les personnes en situation de handicap méritent que l’on recherche des outils qui leur sont propres. Cela donne du sens à mon métier. », explique-t-il. Son mantra : « On n’arrête pas de jouer parce qu’on vieillit, on vieillit parce que l’on arrête de jouer. »

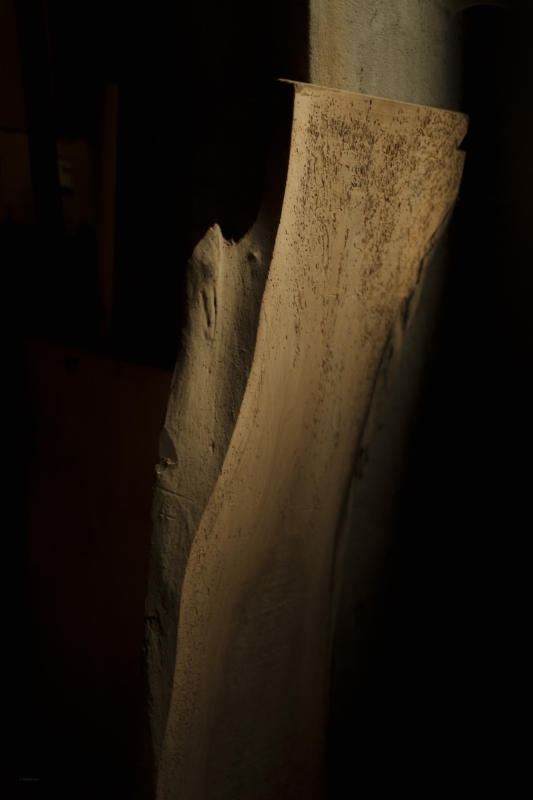







Cet imaginaire ludique, déjà pourvu de 80 jeux conçus en collaboration avec l’association GO Elan, le chantier médiéval de Guédelon ou encore la Maison de la Vache qui Rit, est uniquement issu des forêts jurassiennes. Un travail remarquable qui lui a permis de décrocher le Prix des métiers d’art décerné par la chambre de métiers de la région Bourgogne-Franche-Comté. Une reconnaissance qui est venue parachever son ancrage local. « Les débuts ont parfois été difficiles, mais à présent, je ne quitterai les Montagnes du Jura pour rien au monde. », conclut Bruno.
- Bête à bois, 21 Rue Fontaine du Fresne, 39240 Arinthod
Au nom d’une pipe à Saint-Claude
Après la fabrication de jeux en bois, notre route se poursuit naturellement vers un autre savoir-faire d’exception, tout aussi ancré dans l’âme jurassienne : la pipe de Saint-Claude. Au cœur des Montagnes du Jura, la ville abrite les meilleurs artisans pipiers, dont Sébastien Beaud, à l’atelier Genod Viou, le plus ancien encore en activité.



Lorsque l’on pousse la porte de cet atelier fondé en 1865, l’odeur du bois travaillé nous enveloppe immédiatement. Sur les établis, des copeaux de bruyère s’accumulent en volutes légères. Aux murs, des outils patinés racontent l’histoire d’une fabrication immuable, tandis que des dizaines de pipes, aux formes et finitions variées, attendent leur futur propriétaire. Ici, tout respire la passion du geste juste. « Il faut écouter le bois, respecter ses veines, comprendre comment il va se laisser sculpter. », confie Sébastien Beaud, en manipulant un ébauchon de bruyère encore brute.
L’histoire de la pipe à Saint-Claude remonte au 17e siècle, lorsque les tourneurs sur bois de la région, déjà réputés pour leur savoir-faire, se mirent à façonner des pipes en bois de merisier. Mais c’est avec l’introduction de la bruyère, importée du bassin méditerranéen au 19e siècle, que la ville devint la capitale mondiale de la pipe. À son apogée, au début du 20e siècle, plus de 5 000 ouvriers travaillaient dans les fabriques locales, exportant leur production jusqu’en Amérique et en Asie. Aujourd’hui, l’industrie s’est réduite à une poignée d’ateliers, mais l’âme du métier, elle, demeure intacte.









Sébastien est l’un de ces gardiens du feu. Originaire de Belfort, il découvre d’abord la sculpture sur bois, avant de se passionner pour la pipe, jusqu’à travailler l’été dans la boutique Genod. En 2006, il reprend l’atelier, s’inscrivant ainsi dans la lignée de Jacques Craen et Paul Viou, deux figures emblématiques du métier. « J’ai eu la chance d’apprendre auprès de maîtres-pipiers généreux. Aujourd’hui, c’est à moi de transmettre ce savoir-faire. », explique-t-il.
Et transmettre, il le fait avec cœur. Chaque année, ils sont près de 4 000 visiteurs à pousser la porte de l’atelier pour découvrir les secrets de fabrication de la « noble bouffarde ». Sébastien leur montre chaque étape, de l’ébauchonnage à la finition, en passant par le perçage et le polissage. Il parle du bois, de son vieillissement essentiel : « Une bonne bruyère doit sécher au moins dix ans, certaines ont plus de cinquante ans. », raconte-t-il.
Si la pipe a connu un long déclin, elle revient doucement sur le devant de la scène. Loin du cliché du vieux fumeur solitaire, elle séduit une nouvelle génération, attirée par l’objet, son histoire, son élégance intemporelle. « Ce sont des objets qui ont une âme. », observe Sébastien. Lui-même continue d’innover, créant chaque année de nouveaux modèles, tout en préservant les formes classiques qui ont fait la réputation de la maison Genod. À Saint-Claude, la flamme de la pipe brûle donc encore. Et sous les mains de Sébastien, elle n’est pas près de s’éteindre.
- Atelier Genod Viou – Maître pipier, 13 Faubourg Marcel, 39200 Saint-Claude








Après deux jours de rencontres dans les Montagnes du Jura, une évidence s’impose : ici, le bois fait partie du quotidien des montagnons. Il est un héritage, un lien profond entre l’humain et la montagne. Une matière vivante, à l’image de ce territoire, où l’on vit haut, où l’on vit Jura.
Où manger ?
- Feodor : à Lajoux, dans le parc naturel du Haut Jura, Feodor propose une cuisine entièrement réalisée à l’aide d’un “smoker”, au centre du plus haut village des Montagnes du Jura.
Où dormir ?
- Les Loges du Coinchet : à La Pesse, des hébergements insolites au coeur du Parc naturel régional du Haut-Jura, réalisés avec les ressources locales. Martine et Léna sont deux hôtes accueillantes et profondément attachées à leur territoire.
Comment venir ?
- En train : A seulement 2 heures de Paris en TGV, les Montagnes du Jura sont accessibles facilement par le train. Le TGV dessert, depuis Paris ou Lille, de nombreuses gares SNCF du Jura ou des départements limitrophes : Dole, Mouchard, Bourg en Bresse (Ain), Frasne (Doubs), Vallorbe (Suisse), Bellegarde (Ain). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site SNCF et/ou Mobigo.
- À vélo : Le Jurassic Vélo Tour propose plusieurs dizaines de parcours adaptés aux familles et aux néophytes amateurs de balades à vélo. Coté VTT, Le Jura compte près de 2 000 km de sentiers VTT balisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site France Vélo Tourisme.
- En voiture : Les Montagnes du Jura se situent à 130 km de Lyon et 400 km de Paris. Plusieurs autoroutes et routes nationales vous permettront de rejoindre la destination rapidement (A5, A6, A31, A36, A40 et l’A39 ; N83, N78, N5 et N57). Pour planifier vos itinéraires, rendez-vous sur ViaMichelin ou Mappy.