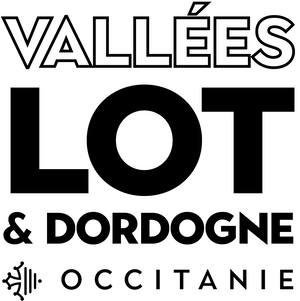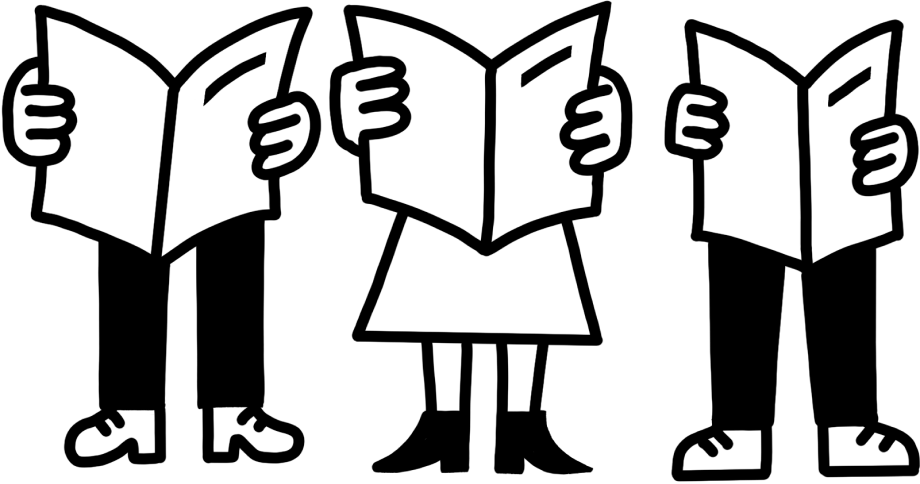Au cœur de hiver, dans les paysages brumeux des causses du Quercy, dans le Lot, des femmes et des hommes scrutent le sol, guidés par leurs chiens, à la recherche de la Truffe noire. Ici, elle a son terroir, ses voix, ses marchés et ses mystères. Râpée sur une omelette, glissée dans un aligot ou vendue au panier chaque mardi dans les rues de Lalbenque, on la célèbre simplement, loin du folklore habituel. Car avant d’être un produit d’exception, la truffe est un produit de la terre, capricieux et exigeant, qui ne se donne qu’à ceux qui savent être patients.
C’est une première pour nous dans le Lot. En arrivant, on devine déjà que la Truffe noire n’est pas ici un produit comme un autre : c’est une fierté locale qui relie la terre, les arbres et les Hommes. Alors on a poussé les portes et tendu l’oreille pour comprendre ce lien né de l’alliance entre un chêne, un mycélium et une certaine idée du temps long. Trufficulteurs, cuisiniers, négociants, habitués du marché de Lalbenque… chaque rencontre a dessiné un visage du Tuber melanosporum, une truffe qui vaut finalement bien plus que son prestige : elle raconte une manière d’habiter le territoire.
Un « diamant noir » sous terre
Une balade dans les Causses du Quercy
Le jour est à peine levé sur les Causses du Quercy. Colin nous a donné rendez-vous au village de Lalbenque, capitale du la truffe noire, notamment réputé pour son marché au truffes. Il ajuste son sac et annonce la couleur : « Si on veut parler de la truffe, il faut d’abord saisir son environnement, son intimité avec le territoire. »


Les Causses du Quercy, ce sont des terres calcaires sculptés par le temps et par l’eau : « On pense qu’il n’y a pas d’eau ici, mais il y en a partout, en dessous. Ce sont des réseaux souterrains. » C’est dans cet environnement sec et bien drainé, que pousse la truffe noire, Tuber melanosporum, ce « diamant du Lot » né de la rencontre entre un arbre et un champignon : « Pour faire de la truffe, il faut un bon copain, un arbre. Dans le Lot, c’est surtout le chêne pubescent qui se caractérise par des petits poils sous les feuilles. Mais ça peut être aussi le noisetier, le charme, ou même certains pins. », raconte le guide.
Colin connaît comme sa poche les paysages qui nous entourent. Il est accompagnateur de randonnée et animateur nature. Pas par hasard. « Moi, j’ai grandi dans les Deux-Sèvres, et tous les étés, on allait randonner dans les Pyrénées avec mes parents. C’est eux qui m’ont donné le goût du dehors. Alors j’ai fait des études de géographie, puis je me suis dit : qu’est-ce que je vais faire derrière un bureau ? Faire de la bagnole pour aller animer des réunions ? Non. Moi, ce que j’aimais, c’était le terrain. », raconte-t-il. Après Toulouse, il choisit de s’ancrer dans le Lot, à Cahors : « Ce qui me manquait à Toulouse, c’était justement ça : un terrain de jeu à portée de pas. Et un ancrage. Ici, je commence à bien connaître le territoire, les sentiers de randonnée, les producteurs. Il y a une forme de légitimité qui vient doucement. »




Nous avançons sur un chemin entre deux truffières qui semblent être en friche : « Vous voyez, les arbres sont plantés à distance pour que le soleil chauffe bien le sol. Parce que la truffe, elle aime la chaleur. Elle pousse dans les 15-20 centimètres sous terre. » Il s’arrête, sort un carnet plastifié, et trace du doigt un schéma coloré : « Voilà le cycle. Les spores sont lâchées en février. Ensuite, elles s’accrochent aux racines, et entre mars et mai, c’est la sexualité du champignon qui se met en place. En août, avec les pluies, les truffes commencent à grossir. Et puis elles mûrissent jusqu’à l’hiver. Une truffe, ça met un an à se développer. »
Le sol, les arbres, la lumière, l’eau, l’air, la patience… et aussi un de peu de chance : « Aujourd’hui, les trufficulteurs plantent avec des plants déjà mycorhizés. Mais même comme ça, même en respectant toutes les conditions, ça reste aléatoire. » Tout au long de la balade, Colin partage ses connaissances sur l’environnement, la géologie, la biodiversité : « Ce que j’aime, c’est montrer comment tout est lié. Le sol influence la végétation, la végétation influence la faune, et tout ça façonne l’habitat, les activités. La truffe, c’est une lecture souterraine du territoire. », explique-t-il.
Après quelques heures de marche et malgré les mystères qui l’entourent encore, nous saisissons combien la truffe s’inscrit déjà dans un paysage et dans un équilibre fragile entre un sol, un arbre et un climat. Et ce n’est qu’un début : un autre visage de la truffe nous attend, pour nous en dire davantage sur son histoire et son commerce.
- Les chemins de Colin, 17 rue François Coppée, 46000 Cahors
Une truffe enracinée chez Maison Pébeyre
« La truffe, c’est pas du luxe, c’est de l’agriculture ! » Pierre-Jean Pébeyre ne mâche pas ses mots. Dans la conserverie discrète de la Maison Pébeyre, nichée au fond d’une rue tranquille de Cahors, l’homme nous accueille avec un clin d’œil : « Vivons heureux, vivons cachés ! » Un sourire franc, une poignée de main solide. Le ton est donné. Depuis cinq générations, ici, on parle truffe sans folklore : « Il y a trop de mythes autour de la truffe. Nous, on essaie de remettre le produit à sa juste place. C’est un champignon, un produit de la terre. »


Dans le Lot, la truffe est une histoire ancienne. « Au 19e siècle, chaque paysan plantait quelques arbres truffiers. La truffe était une forme d’épargne rurale, un revenu d’appoint pour les hivers difficiles. », explique Pierre-Jean. La France connaît alors son âge d’or : on récolte jusqu’à 1 000 tonnes par an, dont une grande partie dans le sud-ouest. Les paysages changent, les causses s’ouvrent, les murets de pierre sèche bordent les truffières, et les marchés s’animent à Lalbenque, Limogne, ou Martel : « C’était une culture paysanne, modeste mais partagée. On allait aux truffes comme on allait aux champignons. » L’après-guerre sonne pourtant le déclin. L’exode rural, l’abandon des terres, la disparition du savoir-faire précipitent la chute des récoltes. Mais certaines familles, comme les Pébeyre, tiennent bon.
L’histoire de la Maison Pébeyre commence en 1897 à Mareuil, petit hameau du nord du Lot. Pierre, l’arrière-grand-père, négocie truffes, foie gras et champignons. En 1920, son fils Alain recentre l’affaire sur le « diamant noir » et installe la conserverie à Cahors : « Il a compris avant tout le monde qu’il fallait se spécialiser pour devenir bon. » C’est Jacques, le père de Pierre-Jean, qui donne à la maison ses lettres de noblesse en l’ouvrant aux plus grandes tables étoilées, en France et à l’étranger. Il initie aussi un pan essentiel de l’aventure : la recherche scientifique. Avec son fils, il se passionne pour les mystères de la naissance de la truffe.
« La truffe, on croit tout savoir, mais en fait on ne sait presque rien. », affirme Pierre-Jean qui poursuit aujourd’hui ces travaux. Depuis 1987, il a même breveté l’arôme naturel de la truffe noire, « une petite révolution à l’époque », et participe à des études sur le cycle biologique du champignon. Il évoque le mycélium, les spores, les pluies d’été, les maturations lentes… avec toujours ce souci de vérité : « Une bonne truffe, qu’elle vienne du Lot, d’Espagne ou d’Australie, elle a le même goût, le même parfum. Il n’y a pas d’effet terroir sur la truffe, parce que ce parfum provient d’une fabrication interne de la truffe. C’est de la chimie, pas du marketing ! », affirme Pierre-Jean.



Derrière ces mots, il y a une volonté tenace : faire tomber le masque du prestige : « Les gens disent : « C’est trop cher, c’est du luxe. » Mais ce n’est pas ça. La truffe, c’est un produit agricole rare, qui demande du temps, de la patience, de l’observation. Et qu’on peut consommer simplement. » C’est aussi ce qui guide la création de produits plus accessibles : huile aromatisée, foie gras truffé à 10 %, crème ou encore beurre…
Dans le bureau comme dans l’atelier, on sent la passion familiale. Elisabeth, son épouse, a accompagné tous les développements. Aujourd’hui, leurs enfants Pierre et Marie sont à leurs côtés. Une aventure à taille humaine, fidèle à ses racines : « On n’a jamais voulu grossir pour grossir. Ce qui nous importe, c’est de comprendre, de transmettre. Et de respecter le produit. » La parole fuse, documentée, engagée. Chez les Pébeyre, on ne vend pas un mythe, mais une matière vivante. Une matière qu’on continue d’interroger, de respecter, et surtout, de partager.
- Pébeyre, 66 rue Frédéric Suisse, 46000 Cahors
Démonstration de cavage au Pech de Jammes
Quand il nous accueille au domaine de Pech de Jammes, près de Cahors, Thomas Chadard nous parle lui-aussi sans détour, comme on raconte une histoire qu’on a eu le temps d’apprivoiser. Après plus de vingt-cinq ans de carrière en concession automobile, il a tout quitté pour s’installer ici, dans cette propriété nichée entre vigne et bois : « Je suis arrivé en 2008. J’habitais encore Cahors, mes enfants allaient bientôt partir. On cherchait une maison à la campagne, on est tombé sur celle-ci un peu par hasard. Elle appartenait à un banquier américain, en pleine crise financière. J’ai pu l’acheter au bon moment. », raconte Thomas.
La maison, certes, mais aussi dix hectares de vignes qu’il n’avait pas franchement cherchés : « Je n’avais aucune intention d’être vigneron. Je ne savais même pas tailler une vigne. » C’est l’amitié qui l’a rattrapé : Bertrand Vigouroux, propriétaire du Château de Haute-Serre, l’encourage à garder les pieds dans les rangs, du moins ceux de Malbec, cépage emblématique du coin. Les années passent, les vignes vieillissent, Thomas replante, vinifie un peu, apprend. Mais ce n’est pas là que bat son cœur.









Il se souvient d’un autre parfum, plus ancien. Celui des truffes dans la gare de Cahors, quand il rentrait de ses études à Toulouse par le train du vendredi soir : « Il y avait des gars qui posaient des sacs pleins de truffes sur le quai. J’ai encore l’odeur dans le nez. » Alors, quand l’occasion se présente, il plante quelques arbres. Puis cent. Puis mille. Et aujourd’hui, 1400 chênes, verts ou pubescents, qui s’étendent sur les anciens coteaux viticoles.
Depuis une dizaine d’années, chaque hiver, il descend dans les truffières avec ses deux chiennes, Nova et Tiny, pour chercher ce champignon mystérieux et capricieux, qui ne se laisse jamais trouver par hasard : « La truffe, c’est comme la chasse. On peut rentrer bredouille. Mais c’est aussi ce qui fait sa magie. » Le chien est laissé libre. Quand il sent l’odeur, il gratte, et l’homme finit de creuser, à la main : « Parfois, les chiens sont rusés. Ils grattent pour rien, juste pour avoir leur récompense. » Rien n’est garanti, tout est affaire de complicité et de patience.
Depuis trois ans, Thomas propose des balades suivies d’un cavage. Pas de truffes cachées pour le folklore. Ici, on vient voir la vraie vie d’une truffière. S’il n’y a rien, on repart avec un peu de beurre truffé, un verre de vin, et une heure au grand air : « J’ai besoin de contact. Recevoir les gens ici, ça me redonne cette sociabilité que j’avais perdue. » Il nous raconte notamment cette rencontre avec cet ancien commissaire de police, venu caver avec sa femme, ému aux larmes en sortant sa première truffe de terre.




Son récit dit aussi beaucoup des campagnes lotoises et de l’histoire de la truffe dans le Sud-Ouest, en écho aux propos de Pierre-Jean : « Autrefois, chaque ferme avait son cochon. Le cochon fouillait le sol, trouvait les truffes. Aujourd’hui, on travaille avec les chiens, c’est plus simple. Mais la truffe reste un mystère. », confirme-t-il. Un mystère fragile : le réchauffement climatique, les arbres qui donnent puis s’arrêtent sans prévenir… « Tout cela exige de la vigilance et du temps long. La truffe, ici, est une affaire de passion, pas de rendement. » À sa façon, discrète et sincère, Thomas incarne cette reconversion que tant rêvent et peu osent. Mais ce qu’il partage surtout, c’est un ancrage nouveau, une manière de vivre au plus près du sol, en connexion avec la nature.
- Chateau Pech de Jammes, 740 route de Vayrols, 46090 Flaujac-Poujols
Les sens en éveil, du marché à l’assiette
Le rendez-vous des gourmands au Marché de Lalbenque
Ce mardi de janvier à Lalbenque, sous une pluie fine et persistante, nous avons assisté à un rituel ancestral, transposé ce jour-là dans la halle du village, pour cause de météo capricieuse. Une première, nous souffle-t-on. Comme un signe, peut-être. Le cœur battant, les paniers couverts de torchons vichy se sont alignés sous les voûtes protectrices de la halle, au lieu de la rue habituelle. Tout s’est pourtant déroulé comme à l’accoutumée : les regards, les gestes et les nombreux marchandages.
Le marché aux truffes de Lalbenque n’est pas un simple rendez-vous hebdomadaire. C’est un cérémonial. Une partition réglée au cordeau, héritée d’une tradition vieille de plusieurs générations. Officiellement institutionnalisé en 1962, ce marché a pourtant bien plus d’un siècle d’histoire. Il fut longtemps animé par les allées et venues des courtiers et des producteurs, venus par le train grâce à la ligne Paris-Toulouse. Le mardi, la gare se remplissait de sacs odorants, expédiés vers les grandes tables du Sud-Ouest et jusqu’à la capitale. Aujourd’hui encore, le marché attire restaurateurs, acheteurs, négociants, curieux, passionnés, tous attirés par le parfum de la Tuber melanosporum.



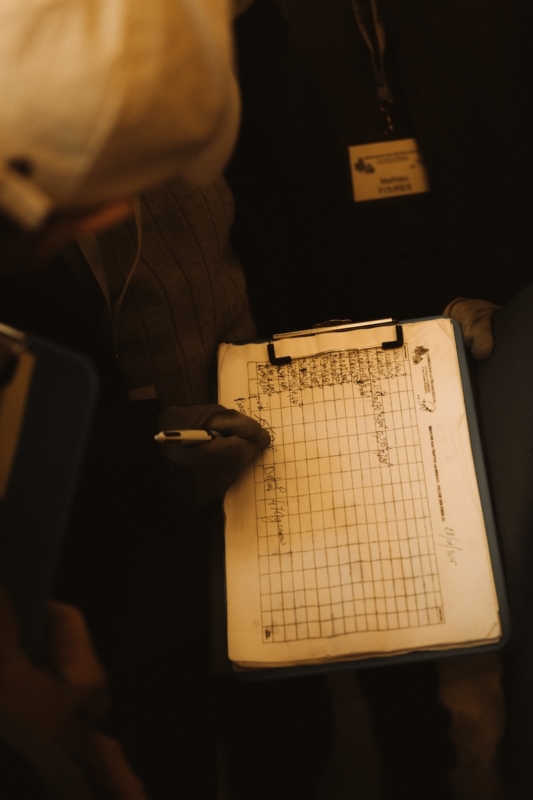



L’organisation ne varie pas : à 13h30, les trufficulteurs installent leurs paniers. Une corde sépare vendeurs et acheteurs, et tant que le coup de sifflet n’a pas retenti, aucune transaction n’est permise. « Avant l’heure, c’est pas l’heure ! », glisse un producteur en haussant les épaules. Les plus impatients rôdent pourtant déjà autour des bancs, flairant l’affaire et jaugeant les paniers du regard. À quinze heures précises, un sifflement clair fend l’air humide. La corde tombe, les échanges commencent.
Alors surgit une autre musique. Celle des voix basses, des billets glissés dans les mains, des torchons qu’on soulève à peine pour laisser entrevoir le précieux champignon. On achète parfois à l’unité, parfois au panier entier. Les prix flirtent avec les 600 euros le kilo. « Regardez celle-là, elle est parfaite ! », s’exclame un habitué. Le marché, ici, c’est aussi un théâtre, un lieu où les récits se mêlent aux odeurs. Et sous les capuches détrempées, des visages s’éclairaient au contact d’un bon panier, d’un acheteur fidèle. « Cette année, ça s’annonce pas trop mal. », soufflait un producteur, un rien prudent. « On a eu de l’eau, ça aide. Mais tout peut changer en une semaine. » On ne le dira jamais assez : la truffe, c’est l’incertitude incarnée.


Même si certains lots finiront sur des tables étoilées, le marché conserve un ancrage terrien : « C’est un produit noble. Et c’est pour ça qu’on le traite avec simplicité. », nous dira un ancien, tout en repliant son torchon. Ce jour-là, le marché n’avait peut-être pas lieu rue du Marché aux Truffes. Il n’en était pas moins authentique. Bien au contraire.
- Marché aux truffes de Lalbenque, rue du marché aux truffes, 46230 Lalbenque
Le goût des bonnes choses au Gindreau
Dans l’ancienne école de Saint-Médard, reconvertie en restaurant étoilé, le chef Pascal Bardet nous accueille comme on accueille chez soi, une poignée de main sincère, un accent chantant, des yeux qui pétillent. Ici, on n’enseigne plus les mathématiques ni la grammaire, mais l’attention, la saison, le goût des bonnes choses. Et cet hiver-là, comme chaque hiver, Le Gindreau s’est laissé envahir par le parfum enivrant de la truffe noire. Les mardis et samedis, Pascal propose des « brunchs truffés » comme il les aime : « casse-croûte » au coin du feu, marché à Lalbenque, démonstration de cavage… Et surtout, un moment de partage.
« La truffe, c’est ma passion depuis gamin. », confie-t-il. Une passion née sur les causses, dans le secret bien gardé d’une grand-mère qui « cavait » sans jamais montrer : « Elle me disait toujours : « Tu es trop petit. » Et je suis resté trop petit jusqu’à son dernier jour. » Il faudra la bienveillance d’un voisin, Jacques, pour lever le mystère : « Il m’a dit : « Ta grand-mère m’a montré, maintenant c’est à moi de te transmettre. » Il m’a emmené devant la maison, m’a montré la mouche, les pierres, les arbres. Depuis, j’ai pas décroché. », raconte-t-il.
Derrière l’amour du produit, il y a l’homme : enraciné, instinctif, libre. À quatorze ans, il sait déjà que les bancs de la fac ne sont pas pour lui : « J’ai toujours eu besoin de comprendre pourquoi je me levais le matin. C’était ça ou devenir agriculteur. Mais j’étais gourmand, j’étais tout le temps dans les jupes de mémé quand elle cuisinait. Et ce goût-là, le goût du terroir, de l’instant, c’est ce que je cherche encore aujourd’hui. » Formé auprès d’Alain Ducasse pendant dix-huit ans, notamment au Louis XV, Pascal Bardet n’a pourtant rien d’un chef figé dans les codes : « Ce qui m’intéresse, c’est que les gens se sentent bien. Avant de parler du plat, tu ouvres une porte, tu sens un truc. Tu sais en trois secondes si tu vas passer un bon moment ou pas. La cuisine, elle vient après. », affirme Pascal.








Cette cuisine, au Gindreau, se nourrit de la terre, des saisons, des relations humaines. Chaque hiver, elle célèbre la truffe noire du Quercy dans toute sa complexité : « Il n’y en a pas une pareille. T’en as des belles qui ne sentent rien, des moins belles qui te retournent. C’est comme les gens, en fait. » Pascal les observe, les renifle, les goûte : « Je suis incapable de choisir à l’avance celle que je vais utiliser. C’est pas une science exacte. C’est vivant. » Il y a quelques années, le chef a planté ses propres truffières. Il y va seul, souvent, avec son chien : « C’est ma thérapie. Moi, j’ai pas besoin de psy. Je vais cavaler dans les causses, je ne parle à personne, je reviens vidé et heureux. », explique-t-il. Cette liberté se ressent jusque dans l’assiette : œuf de ferme imparfait mais diablement truffé, asperges vertes et truffe noire râpée ou encore caillé frais et truffe noire. Même le dessert y passe avec son feuillet croustillant chocolat Dulce et truffe noire.
Le chef doublement étoilé ne joue pas un rôle. Il vit ce qu’il fait. Il aime sa région et parle du Lot avec tendresse, de ses causses, de ses paysans, de ceux qui élèvent, cultivent, cherchent, sans bruit : « C’est eux qu’il faut remercier. Parce que moi, je ne fais que finir le travail. » Quand il évoque les trufficulteurs du coin, il le fait avec respect. Il connaît les aléas, les années sans, les doutes : « Ils bossent comme des dingues pour des récoltes incertaines. Mais quand la saison est bonne, alors tout le monde est content. » Ici aussi, la truffe n’est pas un produit de luxe. C’est un produit de terroir, de patience, de passion. Un lien direct entre la terre et la table. Et à écouter Pascal, on comprend que son métier, il ne le fait pas pour la gloire. Il le fait parce que tout en lui, de son accent à ses casseroles, est truffé d’authenticité.
- Le Gindreau, 146 rue du Gindreau, 46150 Saint-Médard
Et le goût du partage au Lou Bourdié
C’est une auberge de village comme on en rêve. Une bâtisse discrète à Bach, au cœur du Lot, où l’on vous accueille, là aussi, comme à la maison. Ce jour-là, Julie Fouillade nous reçoit pour partager un repas autour de la truffe, servi sur la table dans de grands plats à partager. Potage fumant, brouillade aux truffes, poulet aux morilles et purée parfumée au diamant noir. Le menu est généreux, à son image.



Julie n’est pas lotoise d’origine. Elle vient de Touraine, d’un terroir à vin, fille de vigneron à Chinon : « J’avais décidé d’être sommelière, pas cuisinière. », raconte-t-elle avec un sourire lumineux. Elle a tout appris par étapes : CAP, BEP, bac pro cuisine, brevet pro sommellerie. Des années de formations sérieuses, des maisons exigeantes (l’Auberge de l’Île, le Lion d’Or, L’Ambassade à Béziers) avant de poser ses valises ici, presque par hasard.
En 2005, elle vient prêter main-forte à Monique Valette, la tante de son compagnon, qui tient l’auberge Lou Bourdié. Et là, tout bascule : « Ça a été un coup de foudre pour l’auberge, pour le lieu, pour Monique… Je ne me voyais plus repartir. À la fin de l’été, j’ai dit à Jérôme : « Moi, je reste à Bach. » », se souvient-elle. Elle y restera. Quinze années à travailler aux côtés de Monique, d’abord en salle, puis, peu à peu, en cuisine : « Quand elle a parlé de prendre sa retraite, ses enfants ne voulaient pas reprendre. Moi, je n’avais jamais imaginé ça, mais je n’ai pas voulu que le restaurant s’arrête. Alors j’ai dit : allez, feu ! », raconte Julie. Elle entre en cuisine et passe trois années aux côtés de Monique pour apprendre les gestes et les recettes : « La poule farcie, le ris de veau, la sauce financière… Il fallait qu’on garde cette cuisine-là. »
Depuis 2019, Julie est aux commandes. Elle ne cherche pas à révolutionner l’assiette, mais à faire durer ce qui a fait l’âme du lieu : les plats traditionnels, les produits du coin, le goût du vrai. « Ce sont les recettes d’antan, mais j’y ai forcément mis un peu de moi. » L’auberge a gardé la simplicité des maisons rurales. Les nappes sont épaisses, les plats arrivent fumants sur la table, et les conversations vont bon train. « Ici, tout se partage, le repas, le vin, le temps. On est dans une maison ouverte. » Cette chaleur lui a d’ailleurs valu le trophée Gault&Millau Terroir d’Exception Occitanie en 2023. Une belle reconnaissance pour celle qui, sans rien revendiquer, perpétue une cuisine familiale, incarnée, enracinée.




Et puis il y a la truffe, bien sûr. L’hiver, elle est reine à l’auberge : « La brouillade aux truffes, c’est une institution ici ! », affirme Julie. Pas question d’en faire un produit de luxe, ni de la mettre sous cloche. Elle la sert simplement, dans des plats posés au milieu de la table, pour que chacun se serve.
Finalement, ce dernier repas partagé chez Julie raconte autre chose qu’un menu : une histoire de femmes, de transmission, d’accueil et de fidélité à une terre d’adoption. Et une fois encore, on comprend que dans le Lot, la truffe n’est pas un prétexte à briller. C’est un fil qui relie les gens entre eux, qui raconte une manière d’habiter le territoire, avec chaleur, humilité et authenticité.
- Lou Bourdié, Le bourg, 46230 Bach